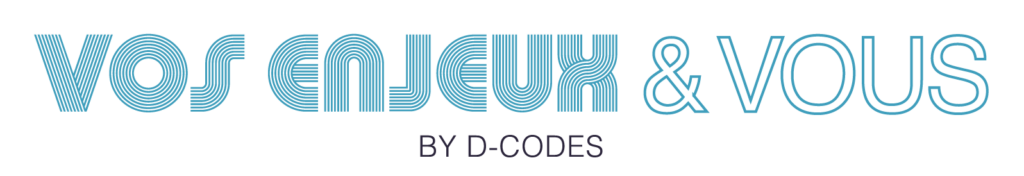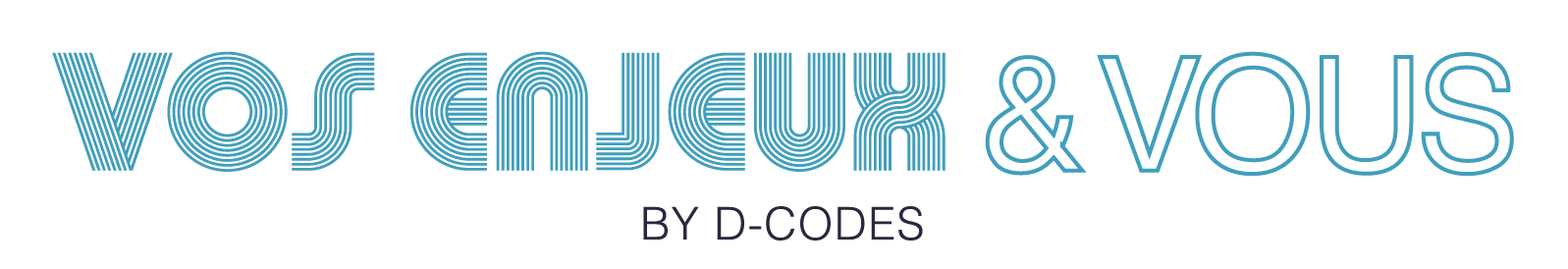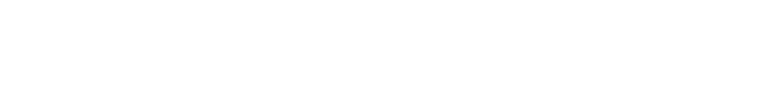- Raphaël Gazel
- 3 juillet 2024
Élections législatives : les facteurs géographiques et sociaux qui divisent la France
La cartographie du vote fait une nouvelle fois émerger une France globalement fracturée. D’une part, de grands espaces ruraux, où le Rassemblement national effectue ses plus gros scores (Nord, Est, Centre). De l’autre, un espace citadin (grandes et villes moyennes, et quelques régions comme une partie de la Bretagne et des pays de l’Ouest) plus communément acquis au Nouveau front populaire ou à Renaissance). Il ne s’agit, bien sûr, pas uniquement d’un vote lié à un simple critère géographique ; des critères sociaux et de ressources y sont étroitement liés.
L’enquête Ipsos réalisée pour France Télévision, Radio France et Public Sénat donne quelques éclairages, montrant une nouvelle fois à quel point le RN dispose d’une faculté à capter le vote ouvrier (57%), et dans une moindre mesure, celui des employés (44%), tandis que les cadres et professions intellectuelles supérieures votent en plus fortes proportions Renaissance ou le Nouveau front populaire.
Le facteur de la rémunération est par ailleurs moins décisif que celui du diplôme : le RN capte massivement le vote des citoyens ayant atteint au mieux le niveau du baccalauréat.

Ainsi, l’une des grilles de lecture de la fracture de la société française va au-delà d’une simple dichotomie entre espaces citadins et ruraux (à cet égard, le quotidien de gens habitant des zones rurales qui ont vu décliner le nombre et la qualité des services publics, est plus proche de celui d’habitants de banlieues dites « modestes », que de celui de résidents de campagnes économiquement plus attractives.)
C’est celle, aussi, d’une distinction selon le niveau de diplôme et de revenus, où une frange de la population, disant les grandes difficultés qu’elle rencontre à subvenir à ses besoins, pâtissant d’un sentiment d’abandon, exprime par le vote son amertume face à des élites (politiques, économiques, intellectuelles) considérées comme déconnectées et qui les auraient délaissées.
Les études que nous avons menées depuis 2020 au cœur d’une période électorale riche, ont mis en évidence l’inquiétude des Français face à l’avenir, les craintes pour l’étiolement du pouvoir d’achat, le ressenti d’être traité « durement », voire avec mépris, par la société, un sentiment enfin de précarisation voire de déclassement latent.
Posant ce constat, le sentiment « d’abandon », repris régulièrement dans l’espace médiatique, n’a rien de neuf. Il est, dans les zones rurales, légitimé par la suppression d’antennes de services publics (bureaux de poste, gare, cliniques) au nom d’une rationalisation économique visant à regrouper ces institutions plutôt que les multiplier. À ces suppressions s’additionnent celles des commerces de proximité (officines de pharmacie, bars, restaurants, petits commerces) qui achèvent de définir des « zones de campagnes en déclin », au cœur desquelles le sentiment d’abandon fait le lit depuis des années du vote RN.
À ceci s’ajoute, à l’ère du numérique et des évolutions technologiques en expansion constante, le principe de dématérialisation des services physiques en services digitaux, et évidemment étendu au champ des services de l’État.
Les services administratifs proposent de plus en plus de procédures en ligne, à des fins de simplification et d’économies. Or, cette dématérialisation génère elle-même une « fracture numérique » qui fragilise celles et ceux qui ne se sentent pas d’affinités avec les nouvelles technologies, mais surtout les populations les plus âgées, les plus précaires, qui ressentent cela comme une nouvelle couche sur le mille-feuille du sentiment d’abandon. Autant de problématiques à résoudre pour les pouvoirs publics.
La perte de pouvoir d’achat, ressentie aujourd’hui par l’ensemble de la population des suites d’une inflation record et persistante ayant touché les énergies, l’alimentation et autres produits de première nécessité constitue la couleur dominante de ce tableau. Et c’est dans une telle société que peuvent s’épanouir des discours opposant une France « qui se lève tôt » et « travaille dur » et celle d’un supposé assistanat, entre des travailleurs français et précaires et une immigration définie comme menaçante pour les emplois des premiers cités… Autant de discours visant à conflictualiser et antagoniser une société aux composantes morcelées, pour mieux en capter le vote.
L’issue du second tour des élections législatives est indécise, et il est hautement improbable qu’une majorité absolue émerge. C’est au contraire une Assemblée aux sièges distribués entre trois principaux blocs antagonistes qui devrait apparaître, avec ce que cette composition peut amener de blocages… ou de compromis. Mais une chose est certaine : les futurs gouvernement et députés œuvreront dans cette France morcelée géographiquement, socialement, où plane dans les territoires l’ombre de l’abandon, où la crise du pouvoir d’achat est durement ressentie, et des inégalités territoriales et sociales se creusent.
Dans cette perspective, le renforcement du pouvoir d’achat, bien sûr, mais également la cohésion des territoires, sont des enjeux essentiels à résoudre pour contribuer à l’apaisement du pays et la conciliation de ses diverses composantes.